Les recherches sur les adultes à haut potentiel souffrent souvent d’un biais discret, mais majeur : le glissement de la définition de la douance entre haut potentiel et performance. Cet article souligne le risque de passer sous silence les adultes HPI vivant des défis particuliers.
On parle beaucoup de haut potentiel, de douance et de zèbre depuis quelques années, et, en ce qui concerne les adultes, ces expressions peuvent se trouver dans différents contextes. Par exemple, on peut parler d’employés à haut potentiel ou d’adultes qui cherchent une évaluation de haut potentiel. Mais parle-t-on vraiment du même haut potentiel et de la même performance attendue dans tous les cas ? Même avec le même mot qui semble précis, c’est-à-dire « haut potentiel », les définitions varient fortement et peuvent glisser d’une approche centrée sur le potentiel à une approche axée sur la performance. Et ce glissement a des impacts vraiment importants.
Glissement du potentiel à la performance
En ce qui touche même les recherches faites sur le sujet — et qui sont déjà peu nombreuses — on rencontre des écueils particuliers. En effet, il devient de plus en plus évident que les recherches sur le haut potentiel chez les adultes sont difficilement comparables. Et cela non seulement parce qu’il y a plusieurs définitions, mais surtout du fait qu’on observe, un glissement méthodologique souvent ignoré. Ce glissement consiste à remplacer la notion de potentiel mesuré par le Q.I. — une promesse, un possible — par une définition de la douance basée sur la performance, c’est-à-dire une réussite déjà en place.
Cela peut sembler banal, mais pourtant, ce changement de perspective a des effets profonds. Ce glissement modifie quels sont les personnes qu’on analyse dans les études sur la douance chez les adultes, et donc cela affecte les résultats des études elles-mêmes.
La notion même de « haut potentiel » renvoie littéralement au potentiel d’émergence ou de développement. Ce mot évoque l’idée de la graine qui contient en elle toute la potentialité de l’arbre en devenir. Cela semble évident lorsqu’on parle d’enfant, mais en passant à l’étude de la population adulte, plusieurs chercheurs délaissent la définition basée sur le potentiel basé sur le Q.I. au profit de définition basée sur la performance observée comme les diplômes obtenus, par exemple.
Un choix méthodologique aux grandes conséquences
L’échantillonnage, c’est la façon dont les chercheurs choisissent les personnes qui vont participer à leur étude. Pour que les résultats soient fiables, il est important que l’échantillon ressemble à l’ensemble du groupe qu’on veut comprendre.
Ainsi, une portion importante des études sur les adultes doués sélectionnent pour leur échantillon de recherche uniquement des individus ayant déjà accompli des performances visibles — académiques, professionnelles ou sociales — comme s’ils étaient la juste représentation de la douance dans son ensemble. Ce choix est souvent motivé par des considérations pratiques (il est beaucoup plus facile de recruter auprès d’une cohorte de finissants universitaires que de trouver un nombre suffisant d’adultes obtenant un certain niveau de Q.I. dans une évaluation de haut potentiel). Mais ce choix crée un biais structurel lourd de conséquences.
Maren Schlegler nomme explicitement ce glissement :
« Une définition fondée sur la performance professionnelle exclut les personnes douées qui, par exemple, n’ont pas pu réaliser leur potentiel en raison de facteurs extérieurs ou de crises personnelles. » 2
Et voilà exactement ce qui m’inquiète. Ce biais a des effets directs sur les résultats des études, qui présentent le haut potentiel majoritairement dans son aspect de facteur protecteur, corrélé à des indicateurs de bien-être, d’ajustement et de réussite. Mais cela peut devenir un raisonnement circulaire :
« La définition de la douance est aussi utilisée comme critère d’inclusion, et, dans le cas de la performance professionnelle, comme critère de réussite. » 1
Cela veut dire qu’on en arrive à des résultats de recherche qui présentent les personnes douées comme vivant de nombreuses réussites, tout en ayant éliminé d’emblée ceux pour qui le potentiel s’est exprimé en marge, peu ou pas du tout.
Mise en contexte
Revenons un peu en arrière… Pendant longtemps, la parole publique sur le haut potentiel intellectuel a été produite par des cliniciens. Ce sont eux qui, les premiers, ont tenté de comprendre les particularités de fonctionnement de leur clientèle en dressant des portraits issus de leur expérience en consultation. C’est dans ce contexte qu’est apparue l’expression de « zèbre », destinée à nommer ceux et celles qui, tout en étant cognitivement brillants, se présentaient en souffrance.
Des zèbres heureux !
Suite aux premières descriptions cliniques qui ont mis l’accent sur les souffrances, il y a eu une réaction de la part des scientifiques qui ont appelé, avec raison, à la prudence : le haut potentiel ne doit pas être systématiquement associé à la souffrance. (Et j’approuve !)
De nombreuses études ont alors présenté une vision plus positive du HPI. Ces travaux sont précieux : ils nous montrent que le haut potentiel peut rimer avec ajustement, stabilité émotionnelle, et épanouissement, dans certains contextes. En tant que psychothérapeute, je m’en inspire beaucoup en travaillant avec mes clients à réintroduire les facteurs favorables dans leur propre vie. Cela peut se faire entre autres en donnant une place à la créativité, et à la stimulation intellectuelle d’une manière adaptée à leur style et à leur personnalité. De simples éléments bien basés sur la compréhension de leur fonctionnement s’avèrent souvent avoir des effets très bénéfiques qui les aides à surmonter les défis rencontrés.
Mais à vouloir corriger un biais…
… il ne faudrait pas tomber dans un autre. Une étude scientifique n’est valide que par la rigueur de ses critères, et notamment par la clarté de ses définitions et la représentativité de son échantillon.
Le biais d’échantillonnage arrive quand les personnes choisies pour une étude ne représentent pas bien la réalité de toute la population étudiée. Cela fausse les résultats, parce que ce qu’on observe dans l’étude n’est pas forcément représentatif de toutes les personnes du groupe concerné.
Or c’est ici que le problème prend toute son ampleur. Le biais d’échantillonnage n’est pas propre aux études basées sur une population qui consulte. Comme on l’a dit, nombre de recherches qui se présentent comme « objectives » sélectionnent uniquement des personnes identifiées comme HPI sur la base de leurs performances, en excluant toute forme de fragilité ou de trajectoire atypique. Ces recherches aussi présentent donc un biais d’échantillonnage.
Pourquoi est-il si difficile d’éviter les biais d’échantillonnage ?
Le profil HPI est déjà reconnu pour sa grande hétérogénéité, c’est-à-dire qu’il n’y a pas deux zèbres similaires, et qu’il y a de nombreuses façons dont la douance peut se vivre et se manifester. Même au niveau des profils de Q.I., il y a régulièrement une part d’hétérogénéité dans les profils des personnes HPI. Cette diversité s’élargit encore lorsqu’on considère la double exceptionnalité, les choix de vie ou préférences atypiques ou les parcours entravés par des facteurs sociaux ou environnementaux.
Il n’y a pas de consensus sur une définition
Une méta-analyse est une recherche qui rassemble les résultats de plusieurs autres études différentes pour essayer d’en tirer une conclusion générale. Cela permet de voir si des résultats observés dans des recherches séparées vont tous dans le même sens. Si les définitions ou les échantillons utilisés dans les études sont trop différents, la méta-analyse devient difficile à interpréter.
Un autre problème majeur est l’absence de définition consensuelle du HPI, surtout chez l’adulte. Cette variabilité des définitions rend extrêmement difficile toute généralisation ou méta-analyse rigoureuse, en plus d’invisibiliser une partie de la population HPI.
De plus, les critères de sélections des chercheurs ne sont pas toujours explicités. Carol A. Carman montre que plus de 75 % des études utilisent des individus préalablement identifiés comme HPI par les écoles, sans décrire clairement les critères retenus.
HPI là, mais pas ici…
Selon les recherches, une même personne sera considérée ou non comme étant à haut potentiel.
« Il est tout à fait possible qu’un participant considéré comme doué dans une étude ne le soit pas dans une autre. » Carol A. Carman 3
Katia Terriot le confirme dans le contexte francophone : même les évaluations fondées sur le QI s’avèrent très hétérogènes, selon les tests utilisés, les indices retenus, ou les interprétations du praticien. Une même personne peut être considérée comme HPI dans une évaluation, et non-HPI dans une autre.
Enfin, Bernadette Vötter et Tatjana Schnell rappellent que tous les individus HPI ne se ressemblent pas. Ces autrices distinguent la douance intellectuelle pure, parfois associée à une plus grande vulnérabilité existentielle, de la douance de performance, plus stable émotionnellement.
« Les personnes douées ne forment pas une population homogène. » Bernadette Vötter et Tatjana Schnell 4
Toutes les recherches citées dans cet article s’accordent sur ce point : l’absence de définition commune empêche une synthèse fiable des données existantes sur le HPI adulte.
Alors quand, en plus, on met l’accent sur les réalisations, les études risquent de nourrir l’illusion d’un profil homogène, stable, performant… Et d’exclure encore plus ceux qui ne correspondent pas à ce moule en passant à côté de la complexité des trajectoires du haut potentiel adulte non axées sur la performance.
Pourquoi c’est important…

D’abord, il ne s’agit pas d’alimenter la polémique, ça n’est pas stratégique et profitable. Il s’agit plutôt, dans un premier temps, d’apprendre à lire les résultats d’articles scientifiques sans leur faire dire autre chose que ce qui en sort réellement.
Ensuite il demeure quand même que, d’après l’ensemble des recherches, ce qui ressort c’est réellement que la majorité des personnes à haut potentiel va bien. Par contre, ceux que j’accompagne, tout comme mes collègues qui accompagnent des personnes à haut potentiel, eh bien c’est justement ceux qui ne vont pas si bien que cela. Et même s’il s’agit d’une minorité de l’ensemble de la population HPI, leur vécu n’en est pas moins important !
Quand je lis des recherches sur les adultes à haut potentiel, mon intérêt est de connaître ce qui permet de guider les intervenants et thérapeutes. Le but est qu’on sache mieux accompagner les adultes en douance vivant des doutes et des mésaventures dans leur parcours de vie, ceux dont la trajectoire n’est pas nécessairement marquée par la performance visible. Donc ce que je recherche, c’est ce que les articles scientifiques peuvent nous dire non pas sur ceux qui n’ont pas besoin d’aide, mais sur ceux qui rencontrent des défis particuliers. Ces personnes douées de manière complexe qui mérite d’être bien accompagné à les dépasser pour pouvoir déployer leur potentiel et accéder eux aussi à l’épanouissement. Alors, il est évident que je déplore que ces personnes soient absentes des échantillons de recherches quand on prend des définitions basées sur la performance.
Conclusion
Ce tour d’horizon révèle un problème méthodologique et éthique majeur : lorsque la performance devient un critère d’inclusion, on invisibilise une part entière de la population HPI. Sont ainsi mis de côté ceux et celles dont le potentiel ne s’est pas exprimé de manière optimale ou productive.
Cela brouille la compréhension du haut potentiel adulte, et empêche la recherche de refléter fidèlement la diversité des trajectoires vécues, y compris celles marquées par la souffrance, la double exceptionnalité ou l’inadéquation sociale.
Reconnaître cette tension entre potentiel et performance, c’est redonner leur place aux voix silencieuses du HPI adulte et restituer toute la diversité des expériences de la douance, au-delà de la réussite observable.
1-« The definition based on occupational performance leads to the exclusion of gifted individuals who, for example, are unable to realize their potential due to external factors or personal crises. » Maren Schlegler
2-“This means that the definition of giftedness is also used as a criterion for inclusion and, in the case of occupational performance, even as a success criterion at the same time.” Maren Schlegler
3- “It is quite possible that one experiment’s gifted participants would not be considered gifted in another experiment.” Carol A. Carman
4— « Recent studies have emphasized the importance of distinguishing different types of giftedness, as gifted individuals do not represent a homogeneous population. » Bernadette Vötter et Tatjana Schnell
____
Carman, C. A. (2013). Comparing apples and oranges: Fifteen years of definitions of giftedness in research. Journal of Advanced Academics, 24(1), 52-70. DOI:10.1177/1932202X12472602
Schlegler, M., Preckel, F., & Vock, M. (2022). The professional situation of gifted adults: A systematic literature review. Frontiers in Psychology, 13, Article 736487. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.736487
Terriot, K. (2018). La douance intellectuelle chez l’adulte : un concept en construction. ANAE — Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant, 154, 9 (1), 6–13.
Vötter, B., & Schnell, T. (2019). Bringing Giftedness to Bear: Generativity, Meaningfulness, and Self-Control as Resources for a Happy Life Among Gifted Adults. Frontiers in Psychology, 10, 1972. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01972

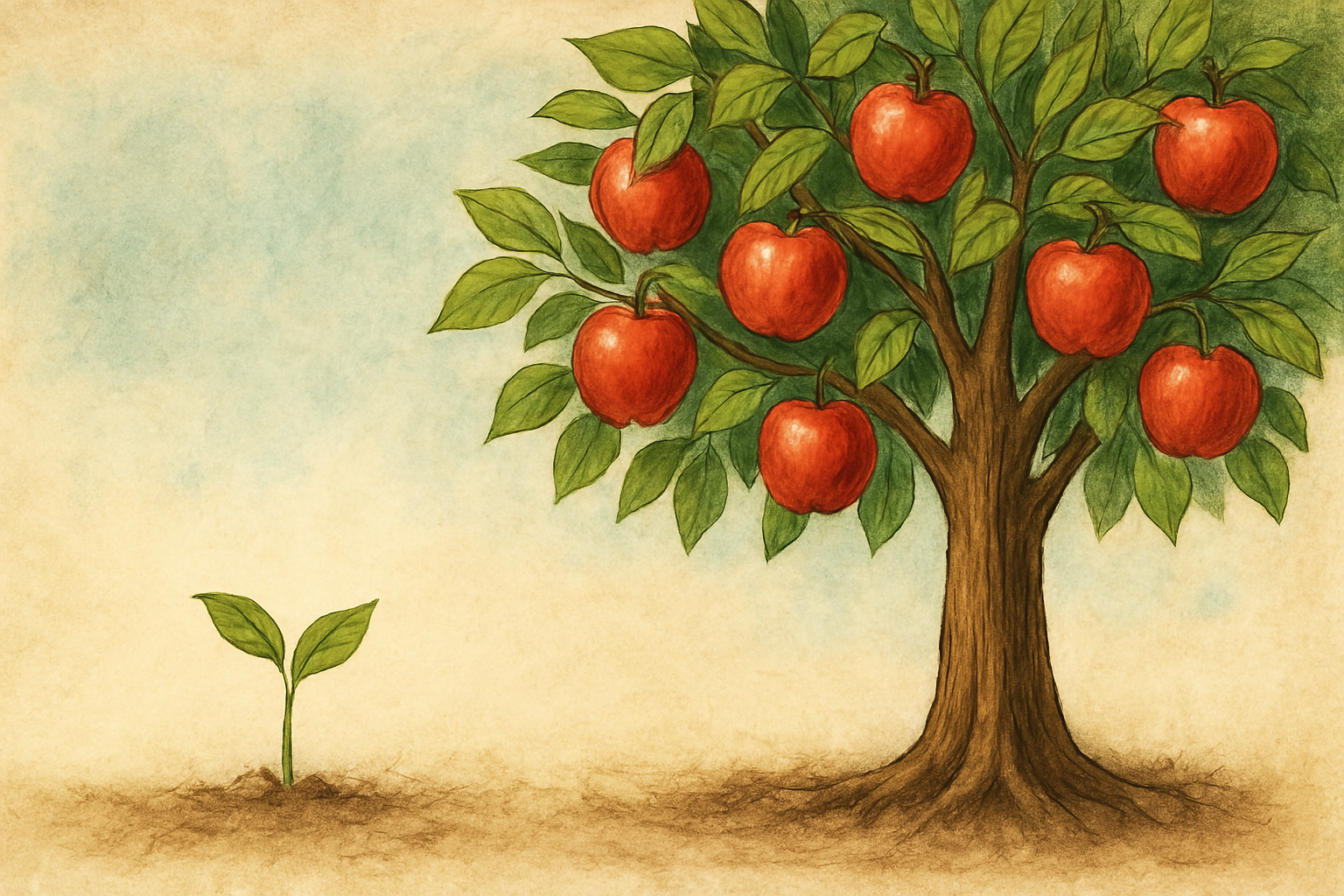
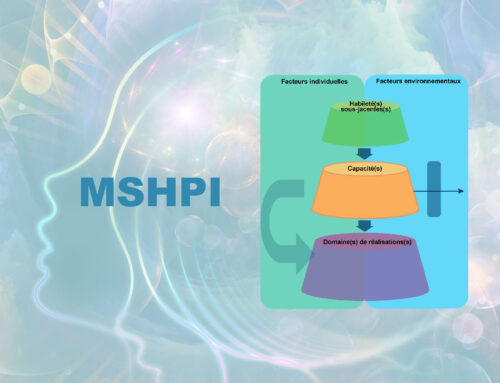

Laisser un commentaire
Vous devez être identifié pour poster un commentaire.